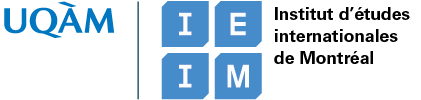Publié en November 2023 dans la Revue internationale des études du développement (N253).
Une analyse des choix stratégiques du CECI
RÉSUMÉ
Le présent article expose la stratégie d’internationalisation du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) élaborée dans le contexte de la politique canadienne et des cadres normatifs internationaux qui appellent au renforcement et à l’autonomisation des écosystèmes. Les résultats de cette recherche partenariale, menée à l’aide d’une méthodologie mixte, révèlent les leviers et les bloquages organisationnels du CECI dans sa stratégie de transformation. Notre analyse, basée sur des auteur·ices des courants critiques de l’action humanitaire au sein des ONG, enrichit le modèle de Perlmutter en mettant en évidence les moments clés de transition lors de la mise en œuvre de la stratégie organisationnelle du CECI afin de décoloniser son réseau.
The present article outlines the internationalization strategy of the Center for International Studies and Cooperation (CECI) developed within the context of Canadian policy and international normative frameworks that call for the strengthening and empowerment of ecosystems. The results of this collaborative research, conducted using a mixed-methods methodology, reveal the organizational drivers and barriers within CECI’s transformation strategy. Our analysis, rooted in the work of critical humanitarian action authors within NGOs, enriches Permultter’s model by highlighting key transition moments during the implementation of CECI’s organizational strategy to decolonize its network.
Mots-clés : internationalisation, stratégies organisationnelles, décolonisation, coopération internationale
Accéder à l’article sur OpenEdition.
PLAN
Introduction
1. Le changement : une voie concrète pour s’engager dans la décolonisation des structures en coopération internationale
2. L’internationalisation : une réforme structurelle présentée comme décolonisante et accessible
3. Méthodologie
4. Résultats
4.1. Des conceptions variées de l’internationalisation
4.2. Ambiguïté des forces décisionnelles
5. Stratégie d’internationalisation : une piste vers une posture décoloniale
5.1. Sensibilités géocentriques et profil holicentrique comme apport théorique
5.2. Positionnement colonial des ONGI ou enjeux des financements
Conclusion
EXTRAIT
« Introduction
Depuis l’adoption des dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) par l’ONU en 2015 et le Sommet humanitaire mondial de 2016 (Savard et al., 2020), des acteurs et actrices des Suds et des Nords remettent en question les inégalités dans l’humanitaire et les approches néocoloniales, appelant à des transformations radicales du secteur (Alouda & Khan, 2022 ; Nothias, 2020 ; Sondarjee & Andrews, 2023). Au Canada, depuis le Grand Bargain de 2016, seulement cinq ententes de contributions ont été signées avec des acteurs et actrices locaux sur 634 projets financés en 2020 (Savard et al., 2021). Malheureusement, certaines organisations négligent encore les hiérarchies présentes dans leurs interactions avec les Suds (Lokot, 2019). Les réflexions récentes sur la décolonisation humanitaire poussent le concept de localisation plus loin. Mbembe (2010) montre que la décolonisation va au-delà de la libération politique des anciennes colonies car elle englobe une libération des esprits et des structures de pouvoir. Cette proposition impacte les stratégies de gouvernance des ONG. En effet, il ne s’agit plus uniquement de reconnaître que les décisions doivent être prises et mises en application par les communautés concernées mais il s’agit également de s’engager et de lutter contre les freins systémiques qui empêchent la création de partenariats équitables dans la pratique humanitaire.
Récemment, la crise sanitaire mondiale de Covid-19 a entraîné un repli de la part des États ainsi que des organismes humanitaires (Paras et al., 2020). Ce retrait a mis en évidence les capacités des organisations des Suds à s’adapter à une nouvelle réalité, sans les volontaires étrangers, sans la présence du siège sur le terrain et avec une nécessité de se numériser rapidement. Cette situation inédite a renforcé le Centre d’étude et de coopération internationale1 (CECI) dans sa volonté stratégique de décolonisation de son réseau, affichée depuis plusieurs années2, en mettant en place un changement organisationnel majeur : une structure de gouvernance internationalisée en faveur de relations de pouvoir plus horizontales avec les partenaires des Suds. Il est à noter qu’au Canada, les enjeux de décolonisation structurelle sont très présents dans les politiques publiques principalement depuis la « crise d’Oka » de 1991 (Giroux, 2017).
Cette étude explore comment cette refonte répond aux enjeux de décolonisation de la culture organisationnelle. À l’instar de Melis & Apthorpe (2020) et Gómez (2021), nous remettons en question le réel impact décolonisant des efforts fournis. La décolonisation des processus de gouvernance du CECI ne met-elle pas trop en avant le CECI Canada (siège), sans intégrer pleinement les acteurs et actrices des Suds ? Le risque étant de participer à ce que Tuck & Yang (2012) nomment « la métaphorisation de la décolonisation ». »
Lire la suite de l’article sur OpenEdition.