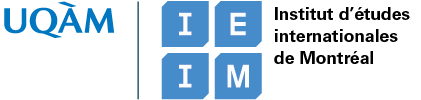Dix ans après le tremblement de terre qui a dévasté « la perle des Antilles », devenue « république des ONG » aux dires de certains, les auteurs nous permettent de nous souvenir, tout simplement. Mais aussi, et peut-être surtout, de ne pas oublier le nécessaire travail de critique de l’aide internationale qu’il reste à faire.
Le 12 janvier 2010, à 16 h 53, un séisme de magnitude 7.3 frappait le centre d’Haïti, transformant sa capitale Port-au-Prince et les villes avoisinantes en champ de ruines. Les trente-cinq secondes de secousse ont entraîné des dégâts considérables qui sont encore visibles aujourd’hui. Rappelons que près de 300 000 personnes sont décédées, dont 60 % des fonctionnaires du pays, et autant de blessés sur les 3,5 millions d’Haïtiens et d’Haïtiennes vivant dans les zones frappées. À la fois victimes et premiers aidants, leur réponse fut immédiate malgré la douleur et le chaos. La réponse internationale ne se fit pas attendre non plus pour faire face aux besoins urgents des sinistrés qui représentaient plus de 15 % de la population haïtienne à l’époque(1). Malgré des manques évidents dans la coordination entre les acteurs, les autorités haïtiennes et la communauté humanitaire internationale, un accès aux soins d’urgence et la délivrance de services de base pour les populations fragilisées furent mis en œuvre. Dans les six mois après l’événement-catastrophe, un million de personnes avaient déjà bénéficié d’une aide alimentaire d’urgence.
Des critiques virulentes et justifiées
Aujourd’hui, force est de constater que le bilan de ces dix années post-tremblement de terre paraît très mitigé : il a d’ailleurs été fortement critiqué. En effet, les évaluations indépendantes font état d’une aide substantielle qui n’aura cependant pas eu d’effet durable. Les médias ont porté un regard très sévère sur les efforts de l’aide internationale, ce qui a contribué largement au cynisme ambiant dans les débats académiques et politiques sur Haïti. L’économiste haïtien Kesner Pharel parle de « décennie perdue », le philosophe et militant haïtien James Darbouze(2) reprend le terme fort d’« haïticide » et le réalisateur haïtien Raoul Peck évoque l’« assistance mortelle » des ONG dans son documentaire éponyme de 2013. Pour ces intellectuels, si la capitale n’a pas été reconstruite, cela ne tient pas uniquement à la mauvaise gouvernance des autorités locales, le mécanisme de solidarité internationale endossant une grande part de responsabilité.
« Haïti a plongé en dix ans dans une crise sociopolitique grave qui paralyse le pays. »
Malgré le travail acharné des organisations humanitaires, leurs effets sont en effet questionnables. Sans parvenir à relever le défi de sa reconstruction post-séisme, Haïti a plongé en dix ans dans une crise sociopolitique grave qui paralyse le pays(3), bien plus violemment depuis 2019, et entrave le processus de deuil. Haïti a aussi été victime de sa « popularité ». Nombre d’individus et d’organisations, sans doute bien intentionnés, ont mis pied dans ce petit pays accessible au fil de la décennie suivante, sans mandat ni autre raison que de « vouloir aider(4) ». Or ce flux d’amateurs a largement noyé les démarches structurantes des organisations professionnelles. Mais comment expliquer de tels résultats malgré un engagement international continu pour Haïti ?
De la «perle des Antilles» à la « république des ONG»
Avant de connaître un tel engouement international, Haïti a été au fil de son histoire un lieu d’intérêt principalement pour l’Église catholique. L’ère répressive Duvalier, à partir de la fin des années 1950, a intensifié l’immigration haïtienne, à l’origine d’une grande diaspora à travers le monde, dont le Québec(5). Cette diaspora s’est battue pour que les gouvernements d’accueil s’engagent dans le soutien au développement du pays d’origine avec qui les liens sociaux n’ont jamais été rompus(6). Quand le président Aristide est renversé en 2004(7), le gouvernement canadien, dans le sillon des États alliés impliqués, s’est retenu d’avoir une position franche, et ce jusqu’aux discussions sur le nouveau traité de libre-échange de 2007. De grandes puissances telles que les États-Unis ou la France se partagent depuis déjà plusieurs décennies la gouvernance de l’État, pendant que les gouvernements haïtiens se succèdent difficilement(8). Il est important de rappeler que les États-Unis ont occupé Haïti de 1915 à 1934 pour protéger leurs intérêts économiques stratégiques et qu’ils ont longtemps soutenu la dictature Duvalier de 1964 à 1986(9). Ce partage de gouvernance par les gouvernements et secouristes étrangers ne s’opère donc pas en 2010 en terrain neutre, faisant resurgir d’anciens contentieux coloniaux en Haïti, dont la France et les États-Unis portent une part importante de responsabilité. Au début des années 2000, le président Préval avait fait preuve d’une grande discrétion dans ses mandats, ce qui fit le lit d’une vision consensuelle portée par les politiques internationales qui investissent dans la sécurité et les services policiers. C’est au printemps 2004 que la MINUSTAH est mise en place avec une force de plus de 9 000 personnels en uniforme. Dans ce contexte de pays fragile, apparaître comme étant en appui à la police peut avoir comme résonnance de soutenir une forme de répression(10).
Lorsqu’il survient en 2010, le séisme est donc « une catastrophe dans une catastrophe » : Haïti est déjà grandement affaiblie et mise sous la tutelle des grandes puissances occidentales(11).
En raison de l’ampleur de l’événement, mais aussi de la complexité et de la fragilité du contexte haïtien, la reconstruction s’est avérée difficile et l’aide internationale, ainsi que les efforts de reconstruction, moins efficaces. La faiblesse de l’État haïtien justifiait alors l’utilisation des organisations internationales (ONG notamment) comme acteurs principaux de la reconstruction. Ce flux massif d’aide internationale, aboutissant à ce que certains ont appelé la « république des ONG », souligne le caractère de spectateur forcé du peuple haïtien. Cela n’aura fait qu’éroder davantage les capacités locales et affaiblir l’embryon d’économie locale restant. On observe d’ailleurs que plusieurs bâtiments comme certains hôpitaux, construits avec des fonds gouvernementaux et l’aide des organisations humanitaires, sont devenus des coquilles vides(12). La phase d’urgence n’a en quelque sorte jamais laissé place à la phase de réhabilitation. Encore faut-il définir le terme « réhabilitation » dans le cadre des États fragilisés. Peut-on réellement appliquer le « build back better » ici ? Le travail des organisations non gouvernementales reste encore aujourd’hui indispensable pour répondre à la survie quotidienne des habitants et habitantes. Ce qui nous renvoie aux nécessaires débats sur la localisation de l’aide visant à favoriser l’autonomisation des populations et l’émancipation des structures locales.
« La phase d’urgence n’a en quelque sorte jamais laissé place à la phase de réhabilitation. »
La majorité de la population haïtienne, jeune, vit sans réelles perspectives d’avenir et est confrontée à la violence grandissante. Cette frustration de la jeunesse s’incarne dans les manifestations contre le pouvoir en place. Alors que de nombreux mouvements politiques haïtiens appellent au départ des puissances politiques occidentales et de ces différents instruments d’aide, la solidarité internationale doit entendre ce cri de la société civile haïtienne : récupérer le pouvoir décisionnel qui échappe actuellement au contrôle des Haïtiens et Haïtiennes, même si cela rime avec d’intenses chocs des idées sur les prochaines décennies. Un autre point à entendre par les acteurs de la solidarité internationale est la révision et l’amélioration des approches dans le cadre des pays fragiles, d’autant plus si ces États sont sujets aux catastrophes dites naturelles et qu’ils ont des relations étroites et de longue durée avec la communauté internationale. Il faut tenter d’abord d’appréhender la fragilité dans toute sa complexité et toutes ses dimensions, la territorialiser et comprendre son unicité, afin, ensuite, de revoir et d’adapter les standards opérationnels et normes de qualités pour, enfin, accompagner et non remplacer les trajectoires de développement avec l’État et les organisations partenaires locales vers une sortie de la fragilité. L’expérience nous a suffisamment démontré qu’Haïti ne pourra jamais se reconstruire de l’extérieur.
| Biographies
Diane Alalouf-Hall • Diane Alalouf-Hall est candidate au doctorat en sociologie à l’Université du Québec à Montréal sous la codirection de Jean-Marc Fontan et de François Audet. À l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires (OCCAH), elle est membre de l’équipe de recherche du projet « Value Chain as Framework for the Design of International Humanitarian Response in Protracted Conflict ». Ses intérêts de recherche portent sur l’impact des pratiques occidentales normatives dans le contexte d’aide internationale. Sa thèse, commencée en 2017, interroge les effets de la standardisation (type Sphère) de l’aide humanitaire dans les États fragiles. François Audet • Directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal depuis mars 2018, François Audet est également professeur à l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et directeur scientifique de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires (OCCAH). Il est titulaire d’un doctorat de l’École nationale d’administration publique (ENAP) de Québec portant sur les processus décisionnels des organisations humanitaires internationales par rapport au renforcement des capacités locales. Avant d’entreprendre une carrière académique, il a cumulé plus de quinze années d’expérience dans le domaine de l’aide humanitaire. Ses intérêts de recherche portent sur les nouvelles pratiques en matière d’aide humanitaire, l’efficacité de l’action humanitaire envers les réfugiés et les politiques canadiennes d’aide au développement. |